-
About
- About Listly
- Community & Support
- Howto
- Chrome Extension
- Bookmarklet
- WordPress Plugin
- Listly Premium
- Privacy
- Terms
- DMCA Copyright
- © 2010-2025 Boomy Labs
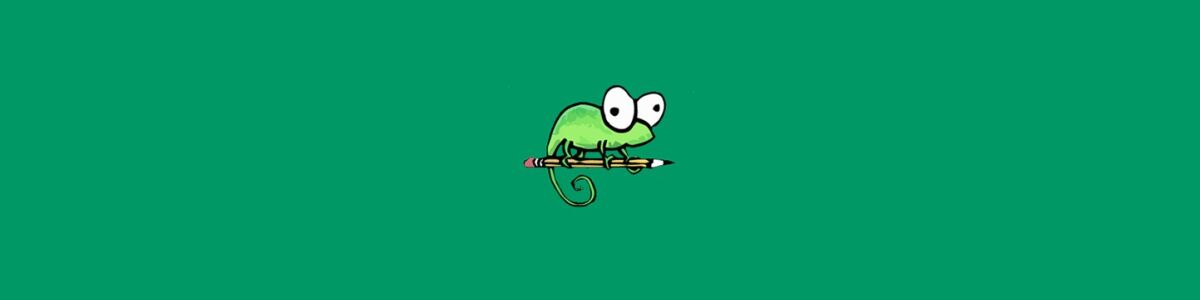
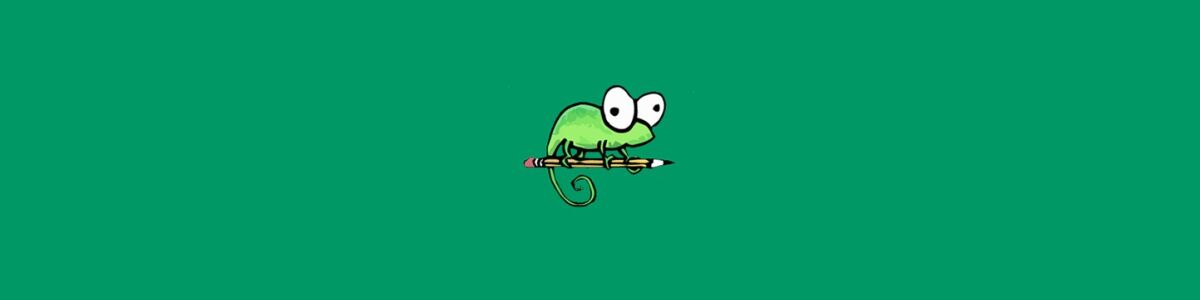
 Марта Гылина
Марта Гылина
Listly by Марта Гылина
C'est une liste interactive des poèmes français où vous pouvez trouver des exemples d'utilisation de la grammaire française. Ajoutez un lien vers cette liste à votre matériel ou site et utilisez-le à l'école!
Ô ciel ! toute la Chine est par terre en morceaux !
Ce vase pâle et doux comme un reflet des eaux,
Couvert d'oiseaux, de fleurs, de fruits, et des mensonges
De ce vague idéal qui sort du bleu des songes,
Ce vase unique, étrange, impossible, engourdi,
Gardant sur lui le clair de lune en plein midi,
Qui paraissait vivant, où luisait une flamme,
Qui semblait presque un monstre et semblait presque une âme,
Mariette, en faisant la chambre, l'a poussé
Du coude par mégarde, et le voilà brisé !
Beau vase ! Sa rondeur était de rêves pleine,
Des boeufs d'or y broutaient des prés de porcelaine.
Je l'aimais, je l'avais acheté sur les quais,
Et parfois aux marmots pensifs je l'expliquais.
Voici l'yak ; voici le singe quadrumane ;
Ceci c'est un docteur peutêtre, ou bien un âne ;
Il dit la messe, à moins qu'il ne dise hihan ;
Ça, c'est un mandarin qu'on nomme aussi kohan ;
Il faut qu'il soit savant, puisqu'il a ce gros ventre.
Attention, ceci, c'est le tigre en son antre,
Le hibou dans son trou, le roi dans son palais,
Le diable en son enfer ; voyez comme ils sont laids !
Les monstres, c'est charmant, et les enfants le sentent.
Des merveilles qui sont des bêtes les enchantent.
Donc, je tenais beaucoup à ce vase. Il est mort.
J'arrivai furieux, terrible, et tout d'abord :
Qui donc a fait cela ? criaije. Sombre entrée !
Jeanne alors, remarquant Mariette effarée,
Et voyant ma colère et voyant son effroi,
M'a regardé d'un air d'ange, et m'a dit : C'est moi.
Sous un grand ciel gris, dans une grande plaine poudreuse, sans chemins, sans gazon, sans un chardon, sans une ortie, je rencontrai plusieurs hommes qui marchaient courbés.
Chacun d'eux portait sur son dos une énorme Chimère, aussi lourde qu'un sac de farine ou de charbon, ou le fourniment d'un fantassin romain.
Mais la monstrueuse bête n'était pas un poids inerte ; au contraire, elle enveloppait et opprimait l'homme de ses muscles élastiques et puissants ; elle s'agrafait avec ses deux vastes griffes à la poitrine de sa monture et sa tête fabuleuse surmontait le front de l'homme, comme un de ces casques horribles par lesquels les anciens guerriers espéraient ajouter à la terreur de l'ennemi.
Je questionnai l'un de ces hommes, et je lui demandai où ils allaient ainsi. Il me répondit qu'il n'en savait rien, ni lui, ni les autres ; mais qu'évidemment ils allaient quelque part, puisqu'ils étaient poussés par un invincible besoin de marcher.
Chose curieuse à noter : aucun de ces voyageurs n'avait l'air irrité contre la bête féroce suspendue à son cou et collée à son dos ; on eût dit qu'il la considérait comme faisant partie de lui-même. Tous ces visages fatigués et sérieux ne témoignaient d'aucun désespoir ; sous la coupole spleenétique du ciel, les pieds plongés dans la poussière d'un sol aussi désolé que ce ciel, ils cheminaient avec la physionomie résignée de ceux qui sont condamnés à espérer toujours.
Et le cortège passa à côté de moi et s'enfonça dans l'atmosphère de l'horizon, à l'endroit où la surface arrondie de la planète se dérobe à la curiosité du regard humain.
Et pendant quelques instants je m'obstinai à vouloir comprendre ce mystère ; mais bientôt l'irrésistible Indifférence s'abattit sur moi, et j'en fus plus lourdement accablé qu'ils ne l'étaient eux-mêmes par leurs écrasantes Chimères.
Deux vieux marins des mer& du Nord
S'en revenaient, un soir d'automne,
De la Sicile et de ses îles souveraines,
Avec un peuple de Sirènes,
A bord.
Joyeux d'orgueil, ils regagnaient leur fiord,
Parmi les brumes mensongères,
Joyeux d'orgueil, ils regagnaient le Nord
Sous un vent morne et monotone,
Un soir de tristesse et d'automne.
De la rive, les gens du port
Les regardaient, sans faire un signe :
Aux cordages le long des mâts,
Les Sirènes, couvertes d'or,
Tordaient, comme des vignes,
Les lignes
Sinueuses de leurs corps.
Et les gens se taisaient, ne sachant pas
Ce qui venait de l'océan, làbas,
A travers brumes ;
Le navire voguait comme un panier d'argent
Rempli de chair, de fruits et d'or bougeant
Qui s'avançait, porté sur des ailes d'écume.
Les Sirènes chantaient
Dans les cordages du navire,
Les bras tendus en lyres,
Les seins levés comme des feux ;
Les Sirènes chantaient
Devant le soir houleux,
Qui fauchait sur la mer les lumières diurnes ;
Les Sirènes chantaient,
Le corps serré autour des mâts,
Mais les hommes du port, frustes et taciturnes,
Ne les entendaient pas.
Ils ne reconnurent ni leurs amis
Les deux marins ni le navire de leur pays,
Ni les focs, ni les voiles
Dont ils avaient cousu la toile ;
Ils ne comprirent rien à ce grand songe
Qui enchantait la mer de ses voyages,
Puisqu'il n'était pas le même mensonge
Qu'on enseignait dans leur village ;
Et le navire auprès du bord
Passa, les alléchant vers sa merveille,
Sans que personne, entre les treilles,
Ne recueillît les fruits de chair et l'or.
Dame d'honneur pardessus les étoiles
Exaltée es très glorieusement,
Allaité as de tes saintes mamelles
Celui qui t'a créé providamment.
Par le fruit que mangea notre grand'mère,
Du lieu de paix fûmes privés jadis
Mais ton saint fruit nous ôte de misère
En nous rendant la joie et paradis.
Tu es la porte où passa le haut roi :
Porte dorée et toute lumineuse
Quand il nous vint tous mettre hors d'émoi :
Toutes gens donc faites chère joyeuse.
Gloire à toi, noble et puissant Seigneur,
De mère né qui est vierge et pucelle,
Au Père aussi, et SaintEsprit honneur,
Tous trois régnant en la gloire éternelle.
J'aime l'araignée et j'aime l'ortie,
Parce qu'on les hait ;
Et que rien n'exauce et que tout châtie
Leur morne souhait ;
Parce qu'elles sont maudites, chétives,
Noirs êtres rampants ;
Parce qu'elles sont les tristes captives
De leur guetapens ;
Parce qu'elles sont prises dans leur oeuvre ;
Ô sort ! fatals noeuds !
Parce que l'ortie est une couleuvre,
L'araignée un gueux;
Parce qu'elles ont l'ombre des abîmes,
Parce qu'on les fuit,
Parce qu'elles sont toutes deux victimes
De la sombre nuit...
Passants, faites grâce à la plante obscure,
Au pauvre animal.
Plaignez la laideur, plaignez la piqûre,
Oh ! plaignez le mal !
Il n'est rien qui n'ait sa mélancolie ;
Tout veut un baiser.
Dans leur fauve horreur, pour peu qu'on oublie
De les écraser,
Pour peu qu'on leur jette un oeil moins superbe,
Tout bas, loin du jour,
La vilaine bête et la mauvaise herbe
Murmurent : Amour !
Près du ruisseau, sous la feuillée,
Menons la Muse émerveillée
Chanter avec le doux roseau,
Puisque la Muse est un oiseau.
Puisque la Muse est un oiseau,
Gardons que quelque damoiseau
N'apprenne ses chansons nouvelles
Pour aller les redire aux belles.
Un méchant aux plus fortes ailes
Tend mille pièges infidèles.
Gardonsla bien de son réseau,
Puisque la Muse est un oiseau.
Puisque la Muse est un oiseau,
Empêchons qu'un fatal ciseau
Ne la poursuive et ne s'engage
Dans les plumes de son corsage.
Mère, veillez bien sur la cage
Où la Muse rêve au bocage.
Veillez en tournant le fuseau,
Puisque la Muse est un oiseau.
Celle dont la dépouille en ce marbre est enclose
Fut le digne sujet de mes saintes amours.
Las ! depuis qu'elle y dort, jamais je ne repose,
Et s'il faut en veillant que j'y songe toujours.
Ce fut une si rare et si parfaite chose
Qu'on ne peut la dépeindre avec l'humain discours ;
Elle passa pourtant de même qu'une rose,
Et sa beauté plus vive eut des termes plus courts.
La Mort qui par mes pleurs ne fut point divertie
Enleva de mes bras cette chère partie
D'un agréable tout qu'avait fait l'amitié.
Mais, ô divin esprit qui gouvernais mon âme,
La Parque n'a coupé notre fil qu'à moitié,
Car je meurs en ta cendre et tu vis dans ma flamme.
Travaillez, prenez de la peine :
C'est le fonds qui manque le moins.
Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.
Gardez vous, leur dit il, de vendre l'héritage
Que nous ont laissé nos parents.
Un trésor est caché dedans.
Je ne sais pas l'endroit ; mais un peu de courage
Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout.
Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'Oût.
Creusez, fouiller, bêchez ; ne laissez nulle place
Où la main ne passe et repasse.
Le père mort, les fils vous retournent le champ
Deçà, delà, partout ; si bien qu'au bout de l'an
Il en rapporta davantage.
D'argent, point de caché. Mais le père fut sage
De leur montrer avant sa mort
Que le travail est un trésor.
En robe grise et verte avec des ruches,
Un jour de juin que j'étais soucieux,
Elle apparut souriante à mes yeux
Qui l'admiraient sans redouter d'embûches ;
Elle alla, vint, revint, s'assit, parla,
Légère et grave, ironique, attendrie :
Et je sentais en mon âme assombrie
Comme un joyeux reflet de tout cela ;
Sa voix, étant de la musique fine,
Accompagnait délicieusement
L'esprit sans fiel de son babil charmant
Où la gaîté d'un bon coeur se devine.
Aussi soudain fusje, après le semblant
D'une révolte aussitôt étouffée,
Au plein pouvoir de la petite Fée
Que depuis lors je supplie en tremblant.
Il ne faudrait pourtant, me disaisje à moimême,
Qu'une permission de notre seigneur Dieu,
Pour qu'il vînt à passer quelque femme en ce lieu.
Les bosquets sont déserts ; la chaleur est extrême ;
Les vents sont à l'amour l'horizon est en feu ;
Toute femme, ce soir, doit désirer qu'on l'aime.
S'il venait à passer, sous ces grands marronniers,
Quelque alerte beauté de l'école flamande,
Une ronde fillette, échappée à Téniers,
Ou quelque ange pensif de candeur allemande :
Une vierge en or fin d'un livre de légende,
Dans un flot de velours traînant ses petits pieds ;
Elle viendrait par là, de cette sombre allée,
Marchant à pas de biche avec un air boudeur,
Ecoutant murmurer le vent dans la feuillée,
De paresse amoureuse et de langueur voilée,
Dans ses doigts inquiets tourmentant une fleur,
Le printemps sur la joue, et le ciel dans le coeur.
Elle s'arrêterait làbas, sous la tonnelle.
Je ne lui dirais rien, j'irais tout simplement
Me mettre à deux genoux par terre devant elle,
Regarder dans ses yeux l'azur du firmament,
Et pour toute faveur la prier seulement
De se laisser aimer d'une amour immortelle.
Que n'aije à te soumettre ou bien à t'obéir ?
Je te vouerais ma force ou te la ferais craindre ;
Esclave ou maître, au moins je te pourrais contraindre
A me sentir ta chose ou bien à me haïr.
J'aurais un jour connu l'insolite plaisir
D'allumer dans ton coeur des soifs, ou d'en éteindre,
De t'être nécessaire ou terrible, et d'atteindre,
Bon gré, mal gré, ce coeur jusquelà sans désir.
Esclave ou maître, au moins j'entrerais dans ta vie ;
Par mes soins captivée, à mon joug asservie,
Tu ne pourrais me fuir ni me laisser partir ;
Mais je meurs sous tes yeux, loin de ton être intime,
Sans même oser crier, car ce droit du martyr,
Ta douceur impeccable en frustre ta victime.
Le soleil semble un phare à feux fixes et blancs.
Du Raz jusqu'à Penmarc'h la côte entière fume,
Et seuls, contre le vent qui rebrousse leur plume,
A travers la tempête errent les goëlands.
L'une après l'autre, avec de furieux élans,
Les lames glauques sous leur crinière d'écume,
Dans un tonnerre sourd s'éparpillant en brume,
Empanachent au loin les récifs ruisselants.
Et j'ai laissé courir le flot de ma pensée,
Rêves, espoirs, regrets de force dépensée,
Sans qu'il en reste rien qu'un souvenir amer.
L'Océan m'a parlé d'une voix fraternelle,
Car la même clameur que pousse encor la mer
Monte de l'homme aux Dieux, vainement éternelle.
Dans la chambre paisible où tout bas la veilleuse
Palpite comme une âme humble et mystérieuse,
Le père, en étouffant ses pas, s’est approché
Du petit lit candide où l’enfant est couché ;
Et sur cette faiblesse et ces douceurs de neige
Pose un regard profond qui couve et qui protège.
Un souffle imperceptible aux lèvres l’enfant dort,
Penchant la tête ainsi qu’un petit oiseau mort,
Et, les doigts repliés au creux de ses mains closes,
Laisse à travers le lit traîner ses bras de roses.
D’un fin poudroiement d’or ses cheveux l’ont nimbé ;
Un peu de moiteur perle à son beau front bombé,
Ses pieds ont repoussé les draps, la couverture,
Et, libre maintenant, nu jusqu’à la ceinture,
Il laisse voir, ainsi qu’un lys éblouissant,
La pure nudité de sa chair d’innocent.
Le père le contemple, ému jusqu’aux entrailles...
La veilleuse agrandit les ombres aux murailles ;
Et soudain, dans le calme immense de la nuit,
Sous un souffle venu des siècles jusqu’à lui,
Il sent, plein d’un bonheur que nul verbe ne nomme,
Le grand frisson du sang passer dans son coeur d’homme.
Dans le brouillard s’en vont un paysan cagneux
Et son bœuf lentement dans le brouillard d’automne
Qui cache les hameaux pauvres et vergogneux
Et s’en allant là-bas le paysan chantonne
Une chanson d’amour et d’infidélité
Qui parle d’une bague et d’un cœur que l’on brise
Oh ! l’automne l’automne a fait mourir l’été
Dans le brouillard s’en vont deux silhouettes grises
C'est l'été. Le soleil darde
Ses rayons intarissables
Sur l'étranger qui s'attarde
Au milieu des vastes sables.
Comme une liqueur subtile
Baignant l'horizon sans borne,
L'air qui du sol chaud distille
Fait trembloter le roc morne.
Le bois des arbres éclate.
Le tigre rayé, l'hyène,
Tirant leur langue écarlate,
Cherchent de l'eau dans la plaine.
Les éléphants vont en troupe,
Broyant sous leurs pieds les haies
Et soulevant de leur croupe
Les branchages des futaies.
Il n'est pas de grotte creuse
Où la chaleur ne pénètre.
Aucune vallée ombreuse
Où de l'herbe puisse naître.
Au jardin, sous un toit lisse
De bambou, Sitâ sommeille :
Une moue effleure et plisse
Parfois sa lèvre vermeille.
Sous la gaze, d'or rayée,
Où son beau corps s'enveloppe,
En s'étirant, l'ennuyée
Ouvre ses yeux d'antilope.
Mais elle attend, sous ce voile
Qui trahit sa beauté nue,
Qu'au ciel la première étoile
Annonce la nuit venue.
Déjà le soleil s'incline
Et dans la mer murmurante
Va, derrière la colline,
Mirer sa splendeur mourante.
Et la nature brûlée
Respire enfin. La nuit brune
Revêt sa robe étoilée,
Et, calme, apparaît la lune.
Viens avec moi, là bas dans la prairie,
Toi dont le coeur est pur ;
Viens avec moi chercher la rêverie
Sous ce beau ciel d'azur.
Jeune fille aux yeux noirs, oui, bien plus que moimême,
O ! je t'aime, je t'aime.
La paquerette à l'aurore vermeille
A fait sécher ses pleurs.
Viens avec moi pour orner ta corbeille
Des plus tendres couleurs.
Jeune fille aux yeux noirs, oui, bien plus que moimême,
O ! je t'aime, je t'aime.
Sous cet ormeau le rossignol qui chante
Voudrait nous retenir,
Quels doux accents, il parle à son amante,
Ah ! c'est pour l'attendrir.
Jeune fille aux yeux noirs, oui, bien plus que moimême,
O ! je t'aime, je t'aime.
Ainsi que lui, que ma lèvre brûlante
T'exprime mes amours.
Je touche aux plis de ta robe flottante
Et te dirai toujours :
Jeune fille aux yeux noirs, oui, bien plus que moimême,
O ! je t'aime, je t'aime.
Un doux baiser sur ta lèvre si rose ?
Ne montre point d'aigreur.
S'aimer, le dire... est une sainte chose
Qui ne porte point malheur.
Jeune fille aux yeux noirs, oui, bien plus que moimême,
O ! je t'aime, je t'aime.
La lampe dans la chambre est une rose blanche
Qui s'ouvre tout à coup au jardin gris du soir ;
Son reflet au plafond dilate un halo noir
Et c'est assez pour croire un peu que c'est dimanche.
La lampe dans la chambre est une lune blanche
Qui fait fleurir dans les miroirs des nénuphars ;
On ne sait plus quel jour il est, ni s'il est tard,
Sauf qu'on est doux comme à la fin d'un beau dimanche.
Sourire de la lampe en sa dentelle blanche
Qu'on dirait une coiffe où dorment des cheveux ;
Lampe amicale aux lents regards d'un calme feu
Qui donne à l'air de chaque soir l'air du dimanche.
J'aime la solitude et me rends solitaire
Pour penser librement à mes belles amours,
Je cherche les forêts et les lieux les plus sourds
Pour leur dire les maux qu'aux mortels je veux taire.
Ils servent à mon deuil de loyal secrétaire,
Recevant les soupirs que je pousse toujours ;
C'est le trésor caché des regrets de mes jours,
L'air en est le registre et le vent le notaire.
Le vent écrit ma plainte et la répand en l'air,
Mes soupirs lui dictant mon martyre sans pair,
Et je me fie à lui parce qu'il n'a point d'âme.
S'il était animé, je tairais mon regret
Parce que j'aime tant en amour le secret,
Qu'on ne sait ni le bien ni le mal de ma flamme.
Puisque làbas s'entr'ouvre une porte vermeille,
Puisque l'aube blanchit le bord de l'horizon,
Pareille au serviteur qui le premier s'éveille
Et, sa lampe à la main, marche dans la maison,
Puisqu'un blême rayon argente la fontaine,
Puisqu'à travers les bois l'immense firmament
Jette une lueur pâle et calme que la plaine
Regarde vaguement,
Puisque le point du jour sur les monts vient d'éclore,
Je m'en vais dans les champs tristes, vivants et doux ;
Je voudrais bien savoir où l'on trouve une aurore
Pour cette sombre nuit que nous avons en nous !
Que fait l'homme ? La vie estelle une aventure ?
Que verraton après et de l'autre côté ?
Tout frissonne. Estce à moi que tu parles, nature,
Dans cette obscurité ?
Puisque nos heures sont remplies
De trouble et de calamités ;
Puisque les choses que tu lies
Se détachent de tous côtés ;
Puisque nos pères et nos mères
Sont allés où nous irons tous,
Puisque des enfants, têtes chères,
Se sont endormis avant nous ;
Puisque la terre où tu t'inclines
Et que tu mouilles de tes pleurs,
A déjà toutes nos racines
Et quelquesunes de nos fleurs ;
Puisqu'à la voix de ceux qu'on aime
Ceux qu'on aima mêlent leurs voix ;
Puisque nos illusions même
Sont pleines d'ombres d'autrefois ;
Puisqu'à l'heure où l'on boit l'extase
On sent la douleur déborder,
Puisque la vie est comme un vase
Qu'on ne peut emplir ni vider ;
Puisqu'à mesure qu'on avance
Dans plus d'ombre on se sent flotter ;
Puisque la menteuse espérance
N'a plus de conte à nous conter ;
Puisque le cadran, quand il sonne,
Ne nous promet rien pour demain,
Puisqu'on ne connaît plus personne
De ceux qui vont dans le chemin,
Mets ton esprit hors de ce monde !
Mets ton rêve ailleurs qu'icibas !
Ta perle n'est pas dans notre onde !
Ton sentier n'est point sous nos pas !
Quand la nuit n'est pas étoilée,
Viens te bercer aux flots des mers ;
Comme la mort elle est voilée,
Comme la vie ils sont amers.
L'ombre et l'abîme ont un mystère
Que nul mortel ne pénétra ;
C'est Dieu qui leur dit de se taire
Jusqu'au jour où tout parlera !
D'autres yeux de ces flots sans nombre
Ont vainement cherché le fond ;
D'autres yeux se sont emplis d'ombre
A contempler ce ciel profond !
Toi, demande au monde nocturne
De la paix pour ton coeur désert !
Demande une goutte à cette urne !
Demande un chant à ce concert !
Plane audessus des autres femmes,
Et laisse errer tes yeux si beaux
Entre le ciel où sont les âmes
Et la terre où sont les tombeaux !
Du rapport d'un troupeau, dont il vivait sans soins,
Se contenta longtemps un voisin d'Amphitrite :
Si sa fortune était petite,
Elle était sûre tout au moins.
A la fin, les trésors déchargés sur la plage
Le tentèrent si bien qu'il vendit son troupeau,
Trafiqua de l'argent, le mit entier sur l'eau.
Cet argent périt par naufrage.
Son maître fut réduit à garder les Brebis,
Non plus Berger en chef comme il était jadis,
Quand ses propres Moutons paissaient sur le rivage :
Celui qui s'était vu Coridon ou Tircis
Fut Pierrot, et rien davantage.
Au bout de quelque temps il fit quelques profits,
Racheta des bêtes à laine ;
Et comme un jour les vents, retenant leur haleine,
Laissaient paisiblement aborder les vaisseaux :
'Vous voulez de l'argent, ô Mesdames les Eaux,
Ditil ; adressezvous, je vous prie, à quelque autre :
Ma foi! vous n'aurez pas le nôtre. '
Ceci n'est pas un conte à plaisir inventé.
Je me sers de la vérité
Pour montrer, par expérience,
Qu'un sou, quand il est assuré,
Vaut mieux que cinq en espérance ;
Qu'il se faut contenter de sa condition ;
Qu'aux conseils de la Mer et de l'Ambition
Nous devons fermer les oreilles.
Pour un qui s'en louera, dix mille s'en plaindront.
La Mer promet monts et merveilles ;
Fiezvousy, les vents et les voleurs viendront.
Les bons amants deux coeurs en un assemblent,
Penser, vouloir, mettent en un désir,
Un chemin vont, jamais ne se dessemblent ;
Ce que l'un veut, l'autre l'a à plaisir.
Point ne les vient jalousie saisir
En vrai amour, car de mal n'ont envie
Amour est bonne ; jaloux ont male vie.
En telle amour l'un l'autre ne mécroit,
Jamais entre eux n'a aucun contredit,
Ce que l'un dit, pour vrai l'autre le croit ;
Nul refus n'a entre eux, en fait ni dit ;
L'un pense bien que l'autre n'a rien dit
Que vérité, et que point ne ferait
Aucune chose que faire ne devrait.
Si par fortune adversité advient
A celle dame qui en amour le tient,
Ou si malade soudainement devient
De meilleur coeur il l'aime et l'entretient ;
La douleur d'elle en son coeur il soutient.
Plus l'aimera ainsi par vérité,
Qu'il ne fera en sa prospérité.
Et si, par mort, l'un d'eux est départi,
Le survivant jà autre n'aimera,
Ni ne prendra jamais autre parti
Car en son coeur l'amour de l'autre aura ;
Comment haïr l'ami soudain pourra
Ce qu'il aimait de coeur si doucement !
Possible n'est de le faire aucunement.
Voyez la teurtre* , qui tant ce fait escorte ;
Quand l'une d'elles sa compagne tôt perd,
La survivante toujours sur branche morte
Prendra repos en grand regret expert.
Chacun connaît que c'est un fait apert
Car sa nature à telle amour ouverte
Qu'el' ne s'assied plus dessus branche verte.
(*) tourterelle
J'ai contenté
Ma voulenté
Suffisamment,
Car j'ai été
D'amour traité
Différemment.
J'ai eu tourment,
Bon traitement,
J'ai eu douceur et cruauté :
Et ne me plains fors seulement
D'avoir aimé si loyaument
Celle qui est sans loyauté.
Coeur affété
Moins arrêté
Qu'un seul moment,
Ta lâcheté
M'a déjeté
Fâcheusement.
Prends hardiment
Amendement.
Et vous, Dames de grand beauté,
Si l'honneur aimez chèrement,
Vous n'ensuivrez aucunement
Celle qui est sans loyauté.
Las ! Mort, qui t'a fait si hardie
De prendre la noble Princesse
Qui était mon confort, ma vie,
on bien, mon plaisir, ma richesse !
Puisque tu as pris ma maîtresse,
Prendsmoi aussi son serviteur,
Car j'aime mieux prochainement
ourir que languir en tourment,
En peine, souci et douleur !
Las ! de tous biens était garnie
Et en droite fleur de jeunesse !
Je prie à Dieu qu'il te maudie,
Fausse Mort, pleine de rudesse !
Si prise l'eusses en vieillesse,
Ce ne fût pas si grand rigueur ;
ais prise l'as hâtivement,
Et m'as laissé piteusement
En peine, souci et douleur !
Las ! je suis seul, sans compagnie !
Adieu ma Dame, ma liesse !
Or est notre amour departie,
Non pourtant, je vous fais promesse
Que de prières, à largesse,
orte vous servirai de coeur,
Sans oublier aucunement;
Et vous regretterai souvent
En peine, souci et douleur.
Dieu, sur tout souverain Seigneur,
Ordonnez, par grâce et douceur,
De l'âme d'elle, tellement
Qu'elle ne soit pas longuement
En peine, souci et douleur !
Voici trois ans qu'est morte ma grand'mère,
La bonne femme, et, quand on l'enterra,
Parents, amis, tout le monde pleura
D'une douleur bien vraie et bien amère.
Moi seul j'errais dans la maison, surpris
Plus que chagrin ; et, comme j'étais proche
De son cercueil, quelqu'un me fit reproche
De voir cela sans larmes et sans cris.
Douleur bruyante est bien vite passée :
Depuis trois ans, d'autres émotions,
Des biens, des maux, des révolutions,
Ont dans les murs sa mémoire effacée.
Moi seul j'y songe, et la pleure souvent ;
Depuis trois ans, par le temps prenant force,
Ainsi qu'un nom gravé dans une écorce,
Son souvenir se creuse plus avant !
